Article
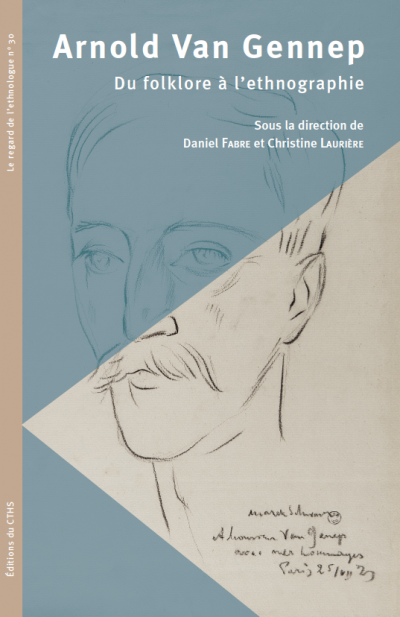
- Année : 2018
- Éditeur : Éditions du CTHS
- Dans ARNOLD VAN GENNEP - 2018
- Pages : 313 à 341
- Collection : Le Regard de l’ethnologue
- Édition : Originale
- Ville : Paris
- ISBN : 978-2-7355-0856-3
- Date de création : 06-01-2021
Résumé
Français
Le chapitre 13 revient sur l’ouvrage qui, parmi la
production de VG, est seul devenu un « classique ». Interrogeant la
notion de « classique », l’auteur montre que ce qui fait (en partie)
le classique est précisément un cocktail de qualités que VG récusait par
ailleurs méthodologiquement (notamment dans son ouvrage Les Demi-savants). On a donc affaire à un paradoxe, l’ouvrage
« classique » de VG, Les Rites
de passage, est sans doute celui qui déroge le plus aux principes
méthodologiques de VG lui-même, principes qui sont pourtant sans doute propices
à produire, selon VG lui-même, une science plus prudente et plus soucieuse
d’objectivité. Les Rites de passage,
en effet, ont atteint le rang de « classique » du fait d’une
propension plus grande à la généralisation, à la production d’une thèse
simplificatrice faisant usage d’une variable unique. Ainsi La formation des légendes, autre ouvrage de VG, plus prudent, plus
circonspect dans ses généralisations, et sans doute tout aussi puissant
scientifiquement selon l’auteur du chapitre, n’a-t-il jamais passé la rampe du
passage au rang de classique.
V. B.