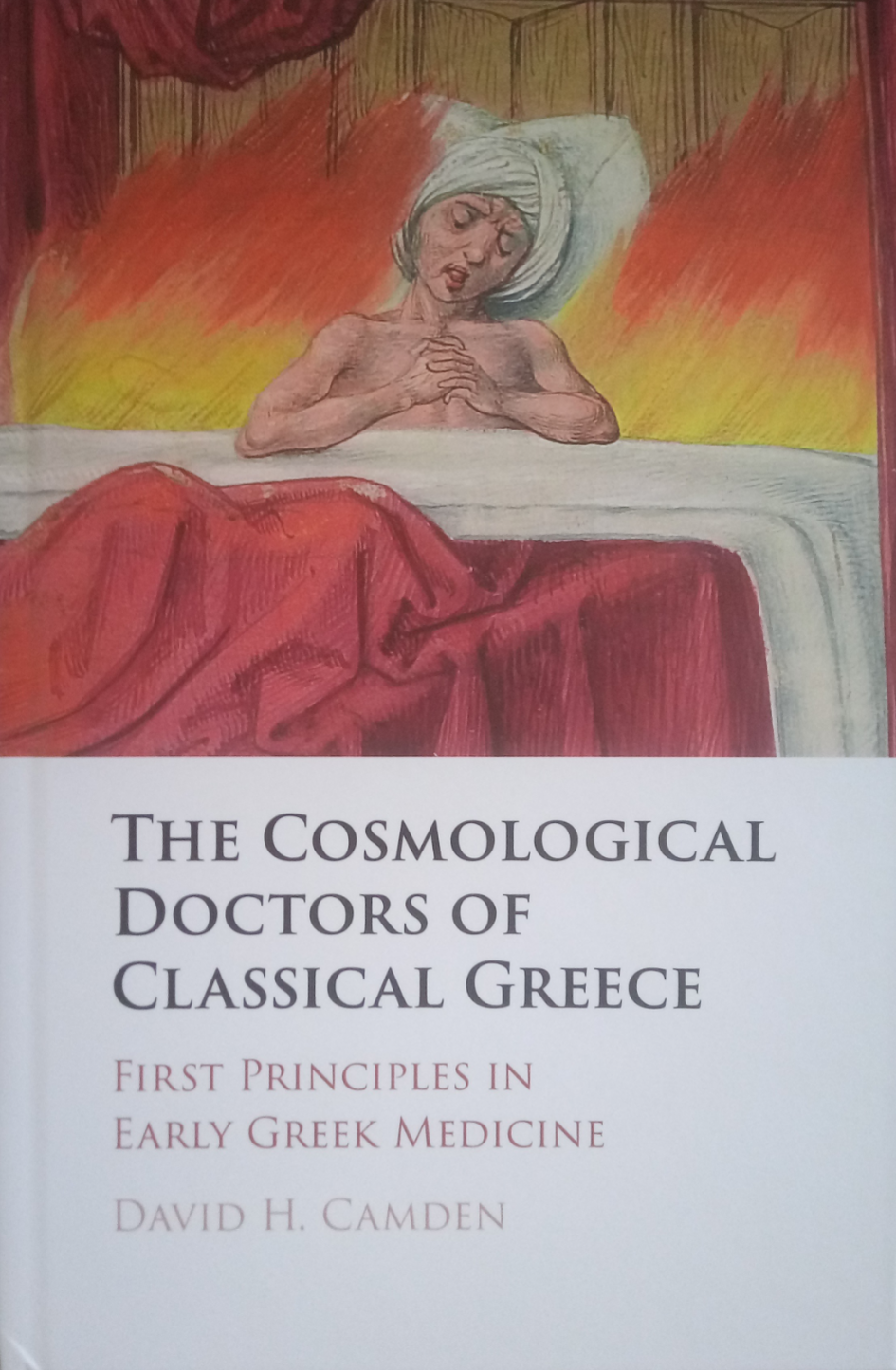
Les traités médicaux dits « hippocratiques », rédigés en langue grecque à partir du Ve siècle avant notre ère, constituent un corpus hétérogène d’auteurs, de datations et de thématiques différentes. L’une des lignes de fracture principales qui traversent ce corpus sépare les traités qui adoptent une perspective cosmologique sur leur objet et ceux qui refusent de le faire. Ceux-là intègrent la réflexion sur la santé du corps humain à celle, plus générale, sur l’ordre du monde, faisant du premier un microcosme à l’image du second. C’est à la catégorie de ces « médecins cosmologistes » (cosmological doctors) qu’est consacré l’ouvrage de David H. Camden. Celui-ci se concentre sur les auteurs des Ve et IVe siècles qui, selon la définition retenue, s’efforcent de « fonder l’art de guérir sur les premiers principes de toute chose » (p. 1, nous traduisons). En particulier, l’ouvrage se penche sur le cas de quatre traités hippocratiques reconnus pour leur approche cosmologique de la médecine, à savoir De la Nature de l’homme (chap. 2), Des vents (chap. 3), Des chairs (chap. 5), Du régime (chap. 6), ainsi que sur trois « témoignages indirects » (secondhand reports, chap. 1) nous renseignant sur les conceptions médicales défendues par ces auteurs, à savoir le traité de l’Anonyme de Londres, le discours d’Eryximaque dans le Banquet de Platon et le traité Ancienne médecine.
L’étude de Camden cherche à réinscrire les développements de ces « médecins cosmologistes » dans la dynamique interne de la science médicale de l’époque. Cette perspective implique, d’une part, d’insister sur la cohérence du corpus hippocratique plutôt que sur sa disparité. Il montre ainsi que les principes de la médecine cosmologique ne se substituent jamais aux explications plus largement admises des causes des maladies, et même que les apports les plus originaux et les plus étonnants de ces traités se comprennent mieux à la lumière des conceptions traditionnelles de la physiologie humaine. La perspective adoptée par l’auteur implique, d’autre part, si ce n’est de contester du moins de reléguer au second plan l’influence des « enquêtes sur la nature » (περὶ φύσεως ἱστορία), développées par les philosophes ioniens depuis Thalès et Anaximandre notamment, sur ces médecins. Quoiqu’il reconnaisse que ce type de traités n’aurait probablement jamais existé sans une tradition préalable de spéculations cosmologiques (laquelle leur a procuré une méthode et un vocabulaire spécifique), Camden soutient toutefois que son autorité ne suffit pas à rendre raison de l’émergence de « médecins cosmologistes » — comme si ces derniers n’avaient fait que suivre une tendance intellectuelle. Son étude s’efforce bien plutôt de mettre au jour les évolutions internes des préoccupations médicales au cours des Ve et IVe siècles de manière à comprendre ce qui a alors rendu nécessaire le recours à des doctrines cosmologiques. Camden souligne en particulier l’intérêt croissant, à cette époque, pour la recherche de généralités : la régularité de certains facteurs pathogènes, les effets systématiques de certaines substances thérapeutiques, les points communs des multiples témoignages de malades. D’un point de vue clinique, cette recherche de généralités permet aux médecins de dépasser l’analyse de cas individuels et de soigner de manière plus efficace ; d’un point de vue épistémologique, elle leur permet de fonder leur connaissance sur des principes généraux plus stables. C’est cela qui caractérise selon lui « l’impulsion cosmologique » de ces médecins (cosmological impulse, chap. 4) et qui explique leur émergence.
L. M.
The so-called “Hippocratic” medical treatises, written in Greek from the fifth century BC onwards, form a heterogeneous corpus with different authors, dates and themes. One of the main dividing lines running through this corpus is between treatises that adopt a cosmological perspective on their subject and those that refuse to do so. The first integrate reflection on the health of the human body with more general reflection on the order of the world, turning the former into a microcosm in the image of the latter. David H. Camden’s book is devoted to this category of “cosmological doctors”. It focuses on the authors of the fifth and fourth centuries who, according to the definition used, endeavoured to “base the art of healing on the first principles of all things” (p. 1). In particular, the book looks at four Hippocratic treatises renowned for their cosmological approach to medicine, namely On the Nature of the Human Being (chap. 2), On Breaths (chap. 3), On Flesh (chap. 5), On Regimen (chap. 6), as well as on three “secondhand reports” (chap. 1) giving us information on the medical conceptions defended by these authors, namely the treatise of the Anonymus Londiniensis, the speech of Eryximachus in Plato’s Symposium and the treatise On Ancient Medicine.
Camden’s study seeks to reintegrate the contributions of these “cosmological physicians” into the internal dynamics of medical science at the time. This perspective means, on the one hand, emphasising the coherence of the Hippocratic corpus rather than its disparity. He thus shows that the principles of cosmological medicine never replace the more widely accepted explanations of the causes of disease, and even that the most original and surprising contributions of these treatises are best understood in the light of traditional conceptions of human physiology. The perspective adopted by the author entails, on the other hand, if not contesting, at least relegating to the background the influence of the “enquiries into nature” (περὶ φύσεως ἱστορία), developed by the Ionian philosophers since Thales and Anaximander in particular, on these doctors. Although he acknowledges that this type of treatise would probably never have existed without a prior tradition of cosmological speculation (which provided them with a specific method and vocabulary), Camden nevertheless argues that its authority is not sufficient to account for the emergence of “cosmological doctors” — as if the latter had merely followed an intellectual trend. Rather, his study seeks to uncover the internal changes in medical preoccupations during the fifth and fourth centuries in order to understand what made it necessary to resort to cosmological doctrines. In particular, Camden stresses the growing interest at this time in the search for generalities: the regularity of certain pathogenic factors, the systematic effects of certain therapeutic substances, the common points of the many testimonies of illnesses, etc. From a clinical point of view, this search for generalities enabled doctors to go beyond the analysis of individual cases and to treat more effectively; from an epistemological point of view, it enabled them to base their knowledge on more stable general principles. This is what he calls the “cosmological impulse” of these doctors (chap. 4), and explains their emergence.
L. M.