Monographie
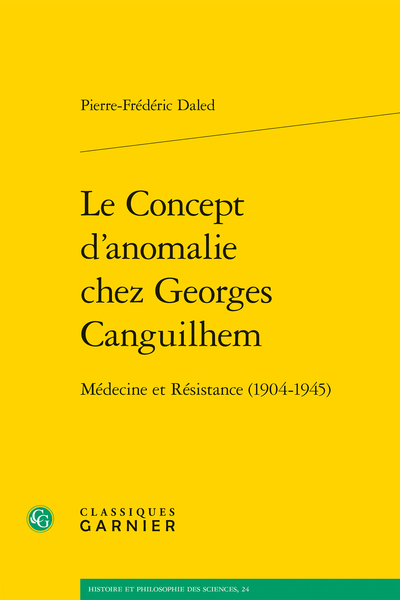
- Année : 2021
- Éditeur : Classiques Garnier
- Pages : 811
- Collection : Histoire et philosophie des sciences
- Édition : Originale
- Ville : Paris
- ISBN : 978-2-406-10461-2
- Date de création : 15-02-2022
- Dernière mise à jour : 21-06-2023
Résumé
Français
Le vaste essai de Pierre-Frédéric Daled (désormais PFD) couvre
une multiplicité de livres sans sacrifier sa cohérence interne. Primo,
il contient le récit de la genèse de la pensée de Canguilhem dans son temps
jusqu’à sa thèse de doctorat de médecine en 1943. Pour rendre compte de cette
genèse, PFD s’appuie sur un énorme travail d’archives. Ce travail relève,
premièrement, d’un formidable effort de datation afin de préciser la
chronologie des sources de la thèse de 1943. Ceci permet de tracer avec finesse
la genèse des notions-clés de la thèse à travers les premières années
d’enseignement de Canguilhem. Ainsi, en témoignent les variations conceptuelles
des notions telles que « valeur », « besoin » et
« polarité » entre la période 1932-1941 ; la première référence
à Goldstein en 1940 (PFD corrige la position de C. Limoges selon laquelle la
référence la plus ancienne à Goldstein de la part de Canguilhem date de 1941) ;
et l’importance croissante de la notion de « normativité » dans son
cours de l’année 1942-1943. Également, grâce à ce travail d’archives, PFD
montre une série de notes manuscrites, postérieurement supprimées dans la
version publiée de la thèse de 1943, qui témoignent de la complexité de la
problématique de l’anomalie, à la fois fait objectif et valeur subjective. Le
but étant non pas de penser Canguilhem contre lui-même, en essayant de montrer
de possibles incohérences, mais de comprendre la puissance de pensée de
Canguilhem à travers des « rééquilibrages » qu’il opère dans sa thèse
de médecine en 1943 au vu du statut problématique de l’anomalie. Secundo,
cet essai de PFD n’est pas seulement une biographie intellectuelle de
Canguilhem. Dans cet essai, PFD introduit des hypothèses centrales de travail
pour réaliser une analyse conceptuelle afin de comprendre la place et le statut
particulier du concept d’anomalie dans la thèse de 1943. PFD propose deux solutions
conceptuelles ou méthodes pour clarifier les variations de Canguilhem quant à
l’anomalie. Premièrement, de manière générale, PFD caractérise la méthode de
Canguilhem d’«oscillante»: sa pensée oscille en effet en
permanence entre deux positions théoriques sans adopter aucune d’elles de
manière définitive et invariante. D’un côté, « le pôle du ni vitalisme ni
holisme intégral ; et, de l’autre côté, le pôle du ni réductionnisme ni
déterminisme intégral. » (p. 729). Cette méthode générale se traduit par
une fluctuation entre faits et valeurs au sein de sa réflexion épistémologique
à l’œuvre dans sa philosophie de la médecine et de la vie. Deuxièmement, PFD
propose un « schéma concentrique » pour comprendre la place de
l’objectivité à propos de l’anomalie au sein de la pensée fondamentalement
évaluative de Canguilhem. Ce schéma est résumé dans ces termes :
« l’anormal (valeur) serait un ensemble plus grand que celui des «
anomalies » (faits) qu’il contient et qui, quant à lui, comporte en son sein l’ensemble
de l’«anomal» répulsif (« monstruosité ») mais aussi celui de l’« anomal »
propulsif. » (p. 399). Ce schéma a l’avantage de montrer une double
oscillation au sein même de la notion d’anomalie sans pour autant renoncer à la
cohérence conceptuelle. D’un côté, l’anomalie oscille entre l’objectif et le
subjectif, étant à la fois fait objectif sans contredire le mot d’ordre
polémique de Canguilhem dans sa thèse selon lequel il n’y a pas de pathologie
objective, mais étant aussi une possible «allure de vie» qui
suppose une évaluation subjective. D’un autre côté, selon Canguilhem, qui
soutient dans sa thèse de 1943 que « toute anomalie n’est pas
pathologique », il y aurait une oscillation entre deux types d’anomalies.
Premièrement, une anomalie pathologique appelée « répulsive » car
objectivement contraire à la normativité vitale et donc nuisible à la vie. Il
s’agit d’une « objectivité dévaluée » (p. 551) et le terme
d’« anomal » lui en est réservé. Deuxièmement, une anomalie
« novatrice », « aberrante sans être incorrecte » (p. 727).
Ce deuxième type d’anomalie représente des valeurs vitales subjectives qui
favorisent potentiellement l’inventivité et la normativité vitales,
questionnant d’autres notions comme celles d’erreur et d’aventure dont PFD
annonce leur importance pour un éventuel deuxième volume de son essai couvrant
les années postérieures à 1945 et donc l’ensemble de la carrière d’enseignant
universitaire de Canguilhem. La fertilité de ces deux hypothèses introduites
par PFD pour analyser l’anomalie dans la thèse de 1943 de Canguilhem permet de
comprendre l’« éthique de la liberté » qui traverse la philosophie
médicale et de la vie de Canguilhem. Cette éthique permettrait d’adopter la
souplesse nécessaire des normes vitales pour faire place, tant
épistémologiquement que médicalement, à l’individuel tout en résistant aux « déviances
monstrueuses de la barbarie politique et médicale » (p. 739) eugéniste
mise en pratique à partir des années 1930 et introduite en théorie autour des
années 1920. La double caractérisation de l’anomalie, à la fois en tant
qu’objectivement pathologique mais aussi laissant une marge de prudence pour
considérer les cas où elle s’avérerait « propulsive », permet de
comprendre que l’expression de cette « barbarie » eugéniste mise en
pratique avec les politiques médicales nazies n’est pas seulement un autre
« normal » (refus du relativisme) ni juste un « anormal »
(refus de l’indifférence) : selon PFD, Canguilhem aurait considéré cette
politique essentiellement anomale, aberrante, comme une erreur objective à
combattre tant sur le plan théorique que pratique. En effet, PFD montre que cette
position est en lien avec la propre vie de Canguilhem, qui s’engage dans la
Résistance à partir de 1941 jusqu’à devenir maquisard au Mont Mouchet en 1944.
PFD montre, au moyen de l’analyse du concept d’anomalie dans la thèse de 1943
et de cette « éthique de la liberté » qui en découle, le lien entre
la philosophie de la médecine de Canguilhem et son engagement à la fois
théorique et pratique contre le nazisme tant sur le plan politique que médical.
Tertio, cet essai fonctionne aussi comme un récit historique de la
période de la première moitié de la vie de Canguilhem. Le but de PFD n’est pas
d’élaborer une histoire comparée, mais de comprendre les sources de la
« perspective de la défiance » (p. 472) de Canguilhem vis-à-vis de
l’enseignement de la médecine et des politiques médicales aberrantes,
«mortifères» tant pour les individus jugés anormaux comme pour la
normativité vitale, de son temps. Même si Canguilhem ne s’est pas positionné
explicitement par rapport aux propos eugénistes et racistes des médecins comme Richet,
Carrel, Verschuer ou Fischer, la reconstruction élaborée par PFD des débats
médicaux et épistémologiques autour de la notion d’anomalie permet de
comprendre comment Canguilhem est arrivé à se soucier de l’anomalie et pourquoi
il lui donne un statut aussi particulier et complexe. En effet, Canguilhem
confère à l’anomalie un statut objectif très rare dans l’ensemble de sa
philosophie afin de se démarquer de la position qui soutenait la suppression
des anormaux, mais aussi afin de soutenir qu’il peut y avoir des anomalies
objectives qu’il faut combattre en tant que « règles de mort de la
vie » (p. 22). Le récit historique développé également dans cet essai
permet aussi de placer certains des intellectuels français les plus illustres
de son temps, condisciples de Canguilhem pendant ses années passées à la rue
d’Ulm. PFD situe, outre Canguilhem, la formation, la carrière et la destinée
d’Aron, de Cavaillès, de Lagache, de Nizan et de Sartre jusqu’à la débouchée de
la Deuxième Guerre mondiale. —Introduction, pp. 7-22 ;
Méthode, pp, 23-31 ; Les « mots » au temps de l’Essai,
pp. 33-51 ; Castelnaudary, l’École Normale Supérieure, l’Agrégation, le
service militaire (1904-1929), pp. 53-69 ; Professeur de Charleville à
Béziers (1929-1936), pp. 71-182 ; Professeur de philosophie et
étudiant en médecine à Toulouse (1936-1939), pp. 183-249 ; De la
« drôle » de guerre à la guerre (1939-1940), pp. 251-286 ;
Professeur de philosophie, étudiant en médecine et résistant à Clermont-Ferrand
(1940-1941), pp. 287-315 ; Élève à Clermont-Ferrand (1941-1942), pp. 317-348 ;
Professeur de philosophie à Clermont-Ferrand (1942-1943), pp. 349-428 ; La
thèse de doctorat en médecine (1943), pp. 429-557 ; La rafle de
l’Université de Strasbourg, Libération-Sud, les Mouvements Unis de
Résistance(1943-1944), pp. 559-589 ; Maquisard au Mont Mouchet,
délégué du commissaire de la République à Vichy (1944), pp. 591-625 ; Vingt
ans après l’École Normale Supérieure (1944-1945), pp. 627-642 ; Pour et
contre l’Essai, pp. 643-680, Aux sources de l’Essai, pp.
681-704 ; Conclusions, pp. 705- 746 ; Bibliographie, pp. 747-776 ;
Index des noms, pp. 777-786 ; Index des journaux et mouvements de
résistance, p. 787 ; Index des notions, pp. 789-802 ; Table des
matières, pp. 803-811.
E. C. M.
Anglais
Pierre-Frédéric Daled's vast essay (hereinafter PFD) covers a multiplicity of books without sacrificing its internal coherence. Firstly, the essay narrates the genesis of Canguilhem's thought until his medical PHD thesis in 1943. In order to account for this genesis, PFD carries out an enormous task of historical files consultation. His work with the historical files reflects, first, a formidable dating effort to delve into the chronology of the intellectual sources of the 1943 thesis. This allows the genesis of the key notions of the thesis to be traced in detail throughout the first lecturing years of Canguilhem where conceptual variations of key notions such as “value”, “need” and “polarity” are found in the 1932-1941 period; as well as the first reference to Goldstein in 1940 (PFD corrects the position of C. Limoges according to which Canguilhem’s first reference to Goldstein dates back to 1941); and the growing importance of the notion of “normativity” for his lectures of the year 1942-1943. In the same way, this consultation of Canguilhem’s historical files, PFD shows a series of handwritten annotations, later suppressed in the published version of the 1943 thesis, annotations that prove the complexity of the problem of the anomaly both as an objective fact and as subjective value. PFD’s aim is not to confront Canguilhem against himself, trying to show possible inconsistencies in his thought, but to manage to understand the power of Canguilhem's thought through the “rebalancing” that he carried out in his 1943 medical PHD thesis in order to deal with the problematic categorization of the anomaly. Secondly, PFD’s essay is not just an intellectual biography of Canguilhem. In this essay, PFD introduces a series of main working hypotheses in order to carry out a conceptual analysis to understand the place and status of the concept of anomaly in the medical PHD thesis. PFD proposes two conceptual solutions or methods to clarify the variations that Canguilhem elaborates on the anomaly. First, in general terms, PFD characterizes Canguilhem's method as “oscillating”: his thought constantly oscillates between two theoretical positions or poles without adopting either of them definitively and invariably. On the one hand, we find “the pole of neither a vitalism nor an integral holism; and, on the other, the pole of neither reductionism nor integral determinism.” (p.729). This general method gives rise to a fluctuation between fact and value in his epistemological reflection, a fluctuation that is to be found in Canguilhem’s philosophy of medicine and philosophy of life. In second place, PFD proposes a “concentric scheme” in order to understand the place of objectivity in relation to anomaly within Canguilhem's fundamentally evaluative thought. This scheme is summarized as follows: “the abnormal (value) would be a set greater than the set of the 'anomalies' (facts), the set of ‘anomalies’ being the one that contains in it the set of the repulsive 'anomalous' ('monstrosity') and also the set of the propulsive 'anomalous'.” (p.399). The advantage of this concentric scheme lies within the possibility of giving of a double oscillation within the very notion of anomaly without renouncing to conceptual coherence. On the one hand, the anomaly oscillates between the objective and the subjective, being at the same time an objective fact without contradicting the controversial motto of Canguilhem's thesis according to which there is no objective pathology, but pathology can also be an “attitude or way of life”, which implies a subjective evaluation. On the other hand, according to Canguilhem, who maintains in his medical PHD thesis that “not all anomalies are pathological”, there is an oscillation between two types of anomalies. In the first place, a pathological anomaly is called “repulsive” because it is objectively contrary to vital normativity and, therefore, is detrimental to life. This type of anomaly is a “devalued objectivity” (p. 551) and the term “anomalous” is reserved for it. In second place, an “innovative” anomaly, “aberrant without being incorrect” (p. 727). This second type of anomaly represents the subjective vital values that could potentially promote vital inventiveness and normativity, which leads to call into question other notions such as those of error and adventure whose importance is announced by PFD for a possible second volume of his essay that will cover the years after 1945 and therefore Canguilhem’s entire career as university lecturer. The fruitfulness of these two hypotheses introduced by PFD in order to analyze the concept of anomaly in Canguilhem's medical PHD thesis allows the understanding of the “ethics of freedom” that runs through Canguilhem's philosophy of medicine and philosophy of life. This ethics of freedom makes it possible to adopt the necessary flexibility of vital norms to make room, both epistemologically and medically, for individuality, thus resisting the “monstrous deviations of political and medical barbarism” (p. 739), eugenic deviations put into practice starting at the 1930s and theoretically introduced around the 1920s. This double characterization of the anomaly, objectively pathological but at the same time leaving a margin of circumspection for those cases in which the anomaly turns out to be “propulsive”, allows us to understand that the expression of this eugenicist “barbarism” put into practice with Nazi medical policies is not just another “normal” state (Canguilhem rejects relativism) nor just an “abnormality” (rejection of indifference): according to PFD, Canguilhem would have considered this policy essentially anomalous, aberrant, an objective error that must be fought both in theory and in practice. Indeed, PFD shows that this position suits the life of Canguilhem himself, who joined the French Resistance in 1941 and who in 1944 became a “maquisard” guerrilla fighter on Mount Mouchet. PFD shows, through the analysis of the concept of anomaly in the medical PHD thesisand through this “ethics of freedom” that derives from the analysis of the anomaly, the correspondence between Canguilhem's philosophy of medicine and his personal commitment, both theoretical and practical, against Nazism both politically and medically. Third, this essay also functions as a historical account of the period that corresponds to the first half of Canguilhem's life. PFD’s aim is not to elaborate a comparative history, but to understand the sources of Canguilhem's “perspective of distrust” (p. 472) towards medical education and towards some medical policies of his time, judged aberrant, “mortiferous” measures, both for individuals considered abnormal and for the very normativity of life. Although Canguilhem did not explicitly took part in relation to the eugenic and racist statements of doctors such as Richet, Carrel, Verschuer or Fischer, the reconstruction elaborated by PFD of the medical and epistemological debates around the notion of anomaly allows us to understand how Canguilhem came to worry about the definition of the anomaly and why he gave this notion such a peculiar and complex categorization. Indeed, Canguilhem gives the anomaly an infrequent objective characterization in the whole of his philosophy in order to distance himself from the contrary position that defended the suppression of the abnormal, but also in order to defend that there may be objective anomalies that must be fought as they represent “deathly rules of life” (p. 22). The historical account also developed in this essay allows us to locate some of the most distinguished French intellectuals of his time, Canguilhem's fellow students during his years spent at rue d'Ulm. PFD places, in addition to those of Canguilhem, the training, career and destiny of Aron, Cavaillès, Lagache, Nizan and Sartre until the end of the Second World War. —Introduction, pp. 7-22; Methodology, pp. 23-31; The “words” at the time of the Essay, pp. 33-51; Castelnaudary, École Normale Supérieure, the Agrégation, military service (1904-1929), pp. 53-69; Professor from Charleville to Béziers (1929-1936), pp. 71-182; Philosophy professor and medical student in Toulouse (1936-1939), pp. 183-249; From “odd” war to War (1939-1940), pp. 251-286; Philosophy professor, medical student and resistance fighter in Clermont-Ferrand (1940-1941), pp. 287-315; Student in Clermont-Ferrand (1941-1942), pp. 317-348; Philosophy professor at Clermont-Ferrand (1942-1943), pp. 349-428; The medical PHD thesis (1943), pp. 429-557; The raid on the University of Strasbourg, Libération-Sud, the Mouvements Unis de Résistance (1943-1944), pp. 559-589; Maquisard in Mont Mouchet, delegate of the Commissioner of the Republic in Vichy (1944), pp. 591-625; Twenty years after the École Normale Supérieure (1944-1945), pp. 627-642; For and against the Essay, pp. 643-680, The sources of the Essay, pp. 681-704; Conclusions, pp. 705-746; Bibliography, pp. 747-776; Name Index, pp. 777-786; Index of journals and resistance movements, p. 787; Index of concepts, pp. 789-802; Table of contents, pp. 803-811.
E. C. M.
Espagnol
El extenso ensayo de Pierre-Frédéric Daled (en adelante PFD) abarca una multiplicidad de libros sin por ello sacrificar su coherencia interna. Primero, el ensayo contiene el relato de la génesis del pensamiento de Canguilhem hasta su tesis doctoral de medicina en 1943. Para dar cuenta de esta génesis, PFD realiza un enorme de trabajo de consulta de archivos. Este trabajo con los archivos refleja, primeramente, un formidable esfuerzo de datación para precisar la cronología de las fuentes de la tesis de 1943. Esto permite rastrear con detalle la génesis de las nociones clave de la tesis a lo largo de los primeros años de la enseñanza de Canguilhem. De esta manera encontramos las variaciones conceptuales de nociones como “valor”, “necesidad” y “polaridad” en el período 1932-1941; así como la primera referencia a Goldstein en 1940 (PFD corrige la posición de C. Limoges según la cual la primera referencia a Goldstein por parte de Canguilhem data de 1941); y la creciente importancia de la noción de “normatividad” en sus clases del año 1942-1943. De igual manera, gracias a este trabajo con los archivos, PFD muestra una serie de anotaciones manuscritas, posteriormente suprimidas en la versión publicada de la tesis de 1943, que atestiguan la complejidad de la problemática de la anomalía al mismo tiempo en tanto que hecho objetivo y que valor subjetivo. El objetivo de FPD no es pensar a Canguilhem contra sí mismo, tratando de mostrar posibles incoherencias, sino llegar a comprender la potencia del pensamiento de Canguilhem a través del “reequilibrio” que realiza en su tesis de medicina de 1943 para abarcar la problemática categorización de la anomalía. Segundo, este ensayo de PFD no es sólo una biografía intelectual de Canguilhem. En este ensayo, PFD introduce una serie de hipótesis de trabajo centrales para llevar a cabo un análisis conceptual con el fin de comprender el lugar y la categoría del concepto de anomalía en la tesis de 1943. PFD propone dos soluciones conceptuales o métodos para aclarar las variaciones que Canguilhem elabora acerca de la anomalía. Primeramente, en términos generales, PFD caracteriza el método de Canguilhem de “oscilante”: su pensamiento oscila constantemente entre dos posiciones teóricas sin llegar a adoptar ninguna de ellas de forma definitiva e invariable. Por un lado, encontramos “el extremo de ni un vitalismo ni de un holismo integral; y, por otro, el extremo de ni un reduccionismo ni de un determinismo integral.” (p. 729). Este método general da lugar a una fluctuación entre hecho y valor en su reflexión epistemológica, fluctuación que encontramos en su filosofía de la medicina y de la vida. En segundo lugar, PFD propone un “esquema concéntrico” para entender el lugar de la objetividad en relación con la anomalía dentro del pensamiento fundamentalmente evaluativo de Canguilhem. Este esquema se resume así: “lo anormal (valor) sería un conjunto mayor que el de las 'anomalías' (hechos), un conjunto que contiene y que, a su vez, incluye en él el conjunto de lo ‘anómalo' repulsivo ('monstruosidad') pero también el de lo 'anómalo' propulsivo.” (p. 399). Este esquema concéntrico tiene la ventaja de mostrar una doble oscilación dentro de la propia noción de anomalía sin renunciar por ello a la coherencia conceptual. Por un lado, la anomalía oscila entre lo objetivo y lo subjetivo, siendo al mismo tiempo un hecho objetivo sin contradecir el polémico lema de la tesis de Canguilhem según el cual no hay patología objetiva, pero también pudiendo ser la patología una “cadencia o manera de la vida”, lo cual implica una valoración subjetiva. Por otra parte, según Canguilhem, que sostiene en su tesis de 1943 que “no toda anomalía es patológica”, hay una oscilación entre dos tipos de anomalías. En primer lugar, una anomalía patológica es llamada “repulsiva” por ser objetivamente contraria a la normatividad vital y, por tanto, perjudicial para la vida. Este tipo de anomalía se trata de una “objetividad devaluada” (p. 551) y a ella se le reserva el término de “anómalo”. En segundo lugar, una anomalía “innovadora”, “aberrante sin ser incorrecta” (p. 727). Este segundo tipo de anomalía representa los valores vitales subjetivos que promueven potencialmente la inventividad y la normatividad vitales, lo que lleva a cuestionar otras nociones como las de error y de aventura cuya importancia la anuncia PFD para un posible segundo volumen de su ensayo que abarcará los años posteriores a 1945 y por tanto la totalidad de la carrera docente universitaria de Canguilhem. La fecundidad de estas dos hipótesis introducidas por PFD para analizar la anomalía en la tesis de Canguilhem de 1943 permite comprender la “ética de la libertad” que atraviesa la filosofía de la medicina y de vida de Canguilhem. Esta ética permite adoptar la flexibilidad necesaria de las normas vitales para dar cabida, tanto epistemológica como médicamente, a la individualidad, resistiendo así a las “monstruosas desviaciones de la barbarie política y médica” (p. 739), desviaciones eugenésicas puestas en práctica a partir de la década de 1930 e introducidas teóricamente hacia la década de 1920. Esta doble caracterización de la anomalía, objetivamente patológica pero a la vez dejando un margen de prudencia para aquellos casos en los que la anomalía resultase “propulsiva”, permite entender que la expresión de esta “barbarie” eugenista puesta en práctica con las políticas médicas nazis no es simplemente otro estado “normal” (Canguilhem rechaza el relativismo) ni solamente una “anormalidad” (rechazo de la indiferencia ): según PFD, Canguilhem habría considerado esta política esencialmente anómala, aberrante, un error objetivo que hay que combatir tanto en la teoría como en la práctica. En efecto, PFD muestra que esta posición está ligada a la propia vida de Canguilhem, quien se unió a la Resistencia francesa en 1941 y que en 1944 llegó a convertirse en guerrillero “maquisard” en el monte Mouchet. PFD muestra, mediante el análisis del concepto de anomalía en la tesis de 1943 y mediante esta “ética de la libertad” que se deriva del análisis de la anomalía, la unión entre la filosofía de la medicina de Canguilhem y su compromiso, tanto teórico como práctico, contra el nazismo tanto en lo político como en lo médico. Tercero, este ensayo también funciona como un relato histórico de la época que se corresponde con la primera mitad de la vida de Canguilhem. El propósito de PFD no es elaborar una historia comparada, sino comprender las fuentes de la “perspectiva de desconfianza” de Canguilhem (p. 472) frente a la enseñanza de la medicina y frente a las medidas políticas en materia de medicina de su época, medidas aberrantes, “mortíferas”, tanto para los individuos considerados anormales como para la propia normatividad vital. Si bien Canguilhem no se posicionó explícitamente en relación con las declaraciones eugenésicas y racistas de médicos como Richet, Carrel, Verschuer o Fischer, la reconstrucción elaborada por PFD de los debates médicos y epistemológicos en torno a la noción de anomalía permite comprender cómo Canguilhem llegó a preocuparse por la definición de la anomalía y por qué le da un categorización tan peculiar y compleja. En efecto, Canguilhem confiere a la anomalía una caracterización objetiva muy rara en el conjunto de su filosofía con el fin de distanciarse de la posición contraria que defendía la supresión de los anormales, pero también con el fin de defender que puede haber anomalías objetivas que deben ser combatidas en tanto que representan “reglas de muerte de la vida” (p. 22). El relato histórico también desarrollado en este ensayo permite ubicar a algunos de los más ilustres intelectuales franceses de su tiempo, compañeros de estudios de Canguilhem durante sus años de estancia pasados en la rue d'Ulm. PFD sitúa, además de las de Canguilhem, la formación, la trayectoria y la fortuna de Aron, de Cavaillès, de Lagache, de Nizan y de Sartre hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. —Introducción, págs. 7-22; Metodología, págs. 23-31; Las “palabras” en la época del Ensayo, págs. 33-51; Castelnaudary, la École Normale Supérieure, la Agrégation, el servicio militar (1904-1929), págs. 53-69; Profesor de Charleville hasta Béziers (1929-1936), págs. 71-182; Profesor de filosofía y estudiante de medicina en Toulouse (1936-1939), págs. 183-249; De la guerra “inusual” a la guerra (1939-1940), págs. 251-286; Profesor de filosofía, estudiante de medicina y combatiente de la resistencia en Clermont-Ferrand (1940-1941), págs. 287-315; Alumno en Clermont-Ferrand (1941-1942), págs. 317-348; Profesor de filosofía en Clermont-Ferrand (1942-1943), págs. 349-428; La tesis doctoral de medicina (1943), págs. 429-557; La redada de la Universidad de Estrasburgo, Libération-Sud, los Mouvements Unis de Résistance (1943-1944), págs. 559-589; Maquisard en Mont Mouchet, delegado del Comisario de la República en Vichy (1944), págs. 591-625; Veinte años después de la École Normale Supérieure (1944-1945), págs. 627-642; A favor y en contra del Ensayo, págs. 643-680, Las fuentes del Ensayo, págs. 681-704; Conclusiones, págs. 705-746; Bibliografía, págs. 747-776; Índice de nombres, págs. 777-786; Índice de periódicos y movimientos de resistencia, pág. 787; Índice de conceptos, págs. 789-802; Tabla de contenidos, págs. 803-811.
E. C. M.