Monographie
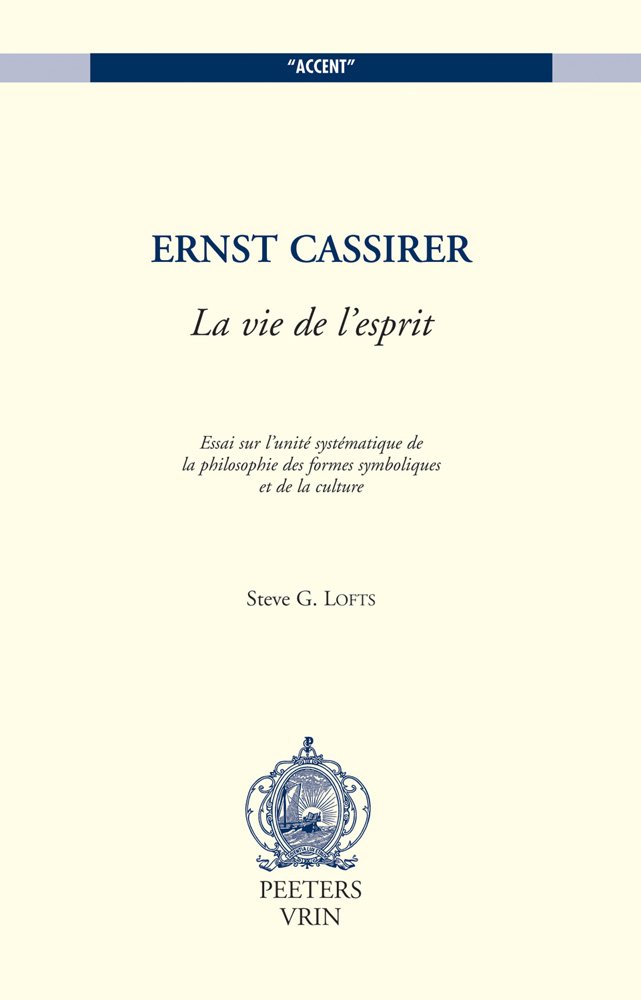
- Année : 1997
- Éditeur : Peeters Publishers
- Pages : 179
- Ville : Louvain
- ISBN : 978-90-6831-962-0
- ISSN : 1378-8736
- Date de création : 04-02-2021
- Dernière mise à jour : 21-06-2023
Résumé
Français
En
1945, au Linguistic Circle of New York, Cassirer donna une conférence intitulée
« Structuralism in modern linguistic ». Au cours de cette conférence,
il qualifia son projet des formes symboliques de « morphologie de
l’esprit » en référence à Goethe. Alors que ce dernier proposa une théorie
des types organiques, et que Humboldt parla de types de langage, Cassirer
chercha à établir les types fondamentaux du Geist (l’Esprit),
c’est-à-dire les fonctions de l’esprit qui construisent le monde de la culture
humaine.
C’est
avec cette référence principale, et l’emploi répété des termes allemand Struktur
et de ses synonymes Aufbau et Gefüge dans le corpus cassirérien, que
Steve G.Lofts justifie son intuition d’un structuralisme avant l’heure au sein
du système de la philosophie des formes symboliques. En effet, Cassirer parle
d’établir avec le système des formes symboliques la structure fondamentale des
différentes activités culturelles humaines telles que le langage, le mythe, la
religion ou bien encore la science. Ces différentes activités seraient les
différents moments de la structure d’une réalité spirituelle et formeraient
ainsi une unité systématique. C’est cette unité systématique des formes
symbolique que Lofts essaye d’établir tout au long du livre en interprétant la
philosophie de Cassirer en termes de structuralisme.
Son
interprétation se déroule en trois moments que l’on peut découper de la manière
suivante dans le livre : l’introduction et le premier chapitre décrivent
le projet et la problématique d’une interprétation structuraliste de la
philosophie des formes symboliques ; les chapitres deux à six développent
chacune des formes symboliques citées par Cassirer (la langage, le mythe, la
religion, la science et l’art) en termes de structuralisme ; enfin la
conclusion explique l’unité fonctionnelle des formes symboliques en tant que
système grâce à la doctrine des Urphanomene (phénomènes fondamentaux).
Ainsi,
dans l’introduction, « Le problème de l’unité de la philosophie cassirerienne
et la question de son interprétation », l’auteur revient d’abord sur les
deux interprétations majeures dans la littérature sur Cassirer. La première
insiste sur la méthodologie et la genèse historique de sa pensée et la deuxième
isole les formes symboliques pour les traiter indépendamment. Toutes deux
nieraient l’unité systématique de pensée de Cassirer. Cela nécessite une
interprétation qui révèlerait cette unité, et c’est ce que Lofts entend faire à
l’aide du structuralisme tel qu’il est défini par Deleuze dans son article
« À quoi reconnait-on le structuralisme ? ». En effet, dans le chapitre
I, « Le symbolique – la structure dynamique de la structure », après
avoir expliqué comment Cassirer, dans Substance et Fonction, substitue
au concept de substance celui de fonction en tant que loi générale qui ordonne
l’être, l’auteur nous explique dans un deuxième temps le concept de fonction
symbolique grâce aux sept caractéristiques que Deleuze attribue au
structuralisme dans son article. Cela lui permet à termes d’expliquer que la
fonction symbolique a deux éléments essentiels : une présence sensible
intuitive (signifiant) et une signification non intuitive (un signifié). Chaque
forme symbolique est l’expression de la fonction symbolique et possède par conséquent
cette structure binaire fondamentale. Ce qui distingue les formes symboliques
entre elles, c’est le rapport entre ces deux éléments. Chacune d’entre elles
représente un rapport possible entre le signifiant et le signifié. Si par
exemple dans le cas de la pensée mythique les deux fusionnent en une unité
absolue, ils sont séparés lors du langage puisque le signifiant représente le
signifié.
Ensuite,
du chapitre II à VI, l’auteur nous explique chacune des formes symboliques
telles qu’elles furent développées par Cassirer dans son corpus et insiste sur
le rapport spécifique qu’elles constituent entre signifiant et signifié. Ainsi,
si dans le cas du langage (Chapitre II) les deux se distinguent, ils forment
une étroite unité dans la pensée mythique (chapitre III). Cette unité est alors
contredite par la religion (chapitre IV) qui reconnait que ce que la pensée
mythique prenait pour le réel (le signifiant lui-même) n’est en réalité qu’une
manifestation de ce dernier. La science (chapitre V), elle, reconnait que le
signe linguistique ne peut jamais correspondre exactement avec ce qu’il désigne
parce qu’il est énoncé par un sujet particulier dans une perspective
particulière. Elle instaure alors une langue universelle dans laquelle le
concept scientifique fait correspondre exactement le particulier avec le
général (le concept). Enfin, l’art (chapitre VI), représente l’harmonie de ces
deux éléments où d’ordinaire l’un des deux domine l’autre dans une forme
symbolique.
Enfin,
dans la conclusion du livre « L’unité de la pensée de Cassirer et la
métaphysique des formes symbolique » l’auteur répond à sa problématique en
s’appuyant notamment sur les notes prises par Cassirer en vue de l’écriture du
quatrième tome de la philosophie formes symboliques. Ainsi, l’unité des formes
symboliques en tant que système se trouve dans le concept de fonction, qui
prime sur celui de substance. Si on considère la diversité des formes
symboliques du point de vue de la métaphysique ancienne (celui de la
substance), on fait des différentes formes culturelles des expressions
différentes et antinomiques d’un être statique. Elles prétendent représenter
l’être unique et vrai et pourtant se contredisent. En revanche, du point de vue
de la fonction, les formes symboliques ont une unité fonctionnelle ; elles
sont des moyens qui permettent à l’esprit de constituer son unité non dans son
origine (la substance) mais dans et par sa finalité (la fonction), son τέλος. Cette finalité est la liberté parce que chaque forme
symbolique contribue à la transition pour l’homme de la « nature » à
la « liberté ». Autrement dit, les diverses formes culturelles
trouvent leur unité dans leur fonction de médiation de la « nature »
à la « liberté ». Leur unité est donc une unité éthique de la
fonction. Cette unité trouverait son expression dans la doctrine des Urphanomene
ou phénomènes fondamentaux, à savoir le Moi, le Toi et le Ça. En effet, les
formes symboliques sont les moments d’un processus qui rend la signification
présente à l’esprit. Ce processus peut être compris en termes de Urphanomene.
Le Moi, la conscience, est une abstraction si elle ne se tourne pas vers
l’extérieur. En se tournant vers l’extérieur, elle rencontre l’altérité du
monde en tant que Gegen-stand (dans le sens étymologique de
« quelque chose qui se met contre et en face de »). Cette altérité est éprouvée comme un Toi.
Mais nous ne devenons connaissables aux autres qu’à travers l’objectivisation,
l’œuvre. Autrement dit, le Moi ne rencontre le Toi qu’à travers la médiation de
l’ordre des signifiants, œuvres ou Ça. Ces signifiants annoncent à l’intérieur
de la conscience une présence autre qu’elle-même. En conséquence, les
différentes formes symboliques sont différentes façons dont la présence du Toi
à la conscience s’exprime à travers l’ordre de la signification, à travers les
œuvres. En termes structuralistes, le Toi est le signifié ultime de tous les
signifiants (la sphère des œuvres, du Ça). Il est la finalité que visent toutes
les significations. Le monde de la culture humaine exprime ainsi au Moi la présence
du Toi. Par conséquent, si la diversité des formes symboliques trouvent leur
unité fonctionnelle dans la médiation de la « nature » à la
« liberté » pour l’homme, c’est parce qu’elles permettent au Moi de
s’extérioriser, de ne pas rester enfermé en lui-même.
En somme, l’unité
systématique des formes symboliques est une unité fonctionnelle. On peut
analyser cette unité en terme de structuralisme parce que chaque forme
symbolique, qui est l’expression de la fonction symbolique, est comme une
structure composée de deux éléments : la sphère du signifiant et celle du
signifié.
Tables des matières, pp. V ;
Avant-propos, pp. VII ; Table des abréviations, pp. IX ;
Introduction, pp. 1-15 ; Chapitre I, pp. 15-39 ; Chapitre II, pp.
39-53 ; Chapitre III, pp. 53-77 ; Chapitre IV, pp. 77-103 ;
Chapitre V, pp. 103-125 ; Chapitre VI, pp. 125-147 ; Conclusion, pp.
147-173 ; Bibliographie, pp. 173- 179.
B. L.