Article
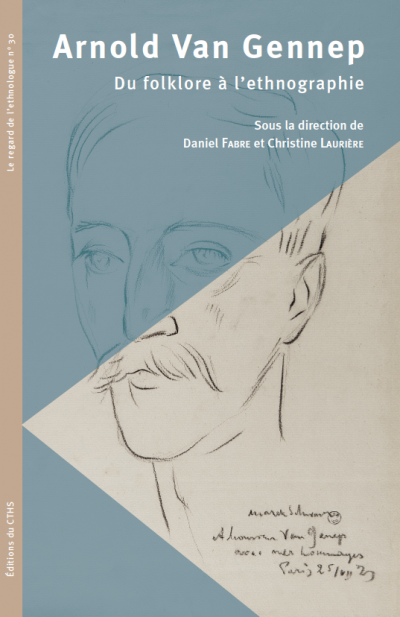
- Année : 2018
- Éditeur : Éditions du CTHS
- Dans ARNOLD VAN GENNEP - 2018
- Pages : 71 à 95
- Collection : Le Regard de l’ethnologue
- Édition : Originale
- Ville : Paris
- ISBN : 978-2-7355-0856-3
- Date de création : 06-01-2021
- Dernière mise à jour : 06-01-2021
Résumé
Français
Le chapitre 3 évalue le
traitement du totémisme opéré par VG en rappelant le rôle fondateur de ce
dernier dans la formation et l’affirmation de la pensée de VG. Depuis le
mémoire de fin d’études sur Madagascar (1903), d’abord conçu avec Marillier
puis soutenu avec Mauss après la mort du premier, en passant par l’étude sur
l’Australie (1906) et jusqu’à la thèse de 1921, c’est un motif qui ne quitte
pas VG. Ce dernier y affirme son approche vivante du totémisme, c’est-à-dire à
comprendre comme élément d’inscription et d’affirmation de l’individu dans le
clan, plutôt que l’inverse (selon la lecture durkheimienne). Ces longues années
d’étude sur le sujet sont ainsi celles d’une prise de distance de plus en plus
marquée de la part de VG à l’égard de l’école sociologique durkheimienne. Cette
distance s’accompagne d’un rapprochement avec l’école d’anthropologie
britannique (Frazer).
V. B.