Monographie
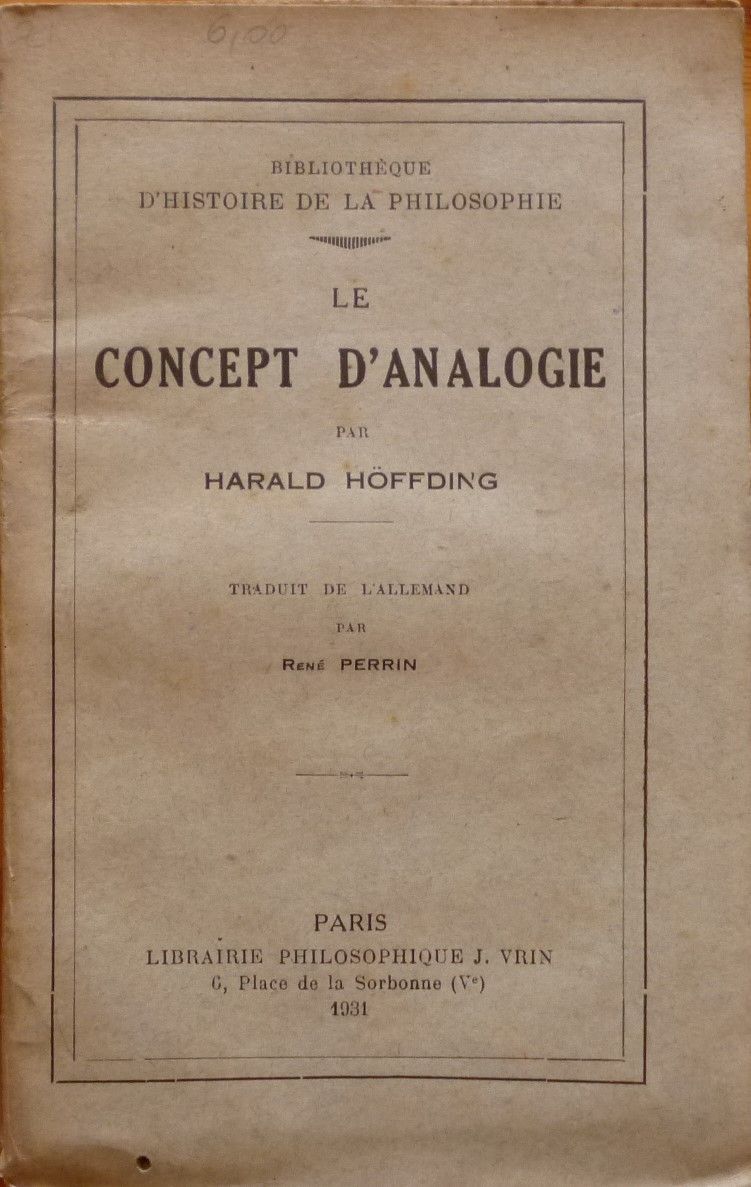
- Année : 1931
- Éditeur : Vrin
- Traducteur(s) : René PERRIN
- Pages : 154
- Édition : Première traduction française
- Ville : Paris
- Date de création : 08-12-2020
- Dernière mise à jour : 21-06-2023
Résumé
Français
Ni Aristote ni
Kant ne comptent l’analogie parmi les catégories ; on ne saurait pourtant rendre
compte sans elle de la nature et de la valeur de la pensée. L’analogie n’est
pas une simple approximation de l’identité mais une catégorie formelle à part
entière. Elle assume trois fonctions principales : de découverte
(l’analogie mène à l’hypothèse scientifique), de synthèse (l’analogie est le
dernier lien entre objets et séries d’objets), d’évocation (l’analogie exprime
l’aspiration à l’unité et à la continuité de la vie) («Introduction»,
p. 7-12).
Le chapitre 1,
« Analogies involontaires » (p. 13-44) se nourrit de
l’ethnographie contemporaine – en particulier de ce que Lévi-Bruhl nomme
« loi de participation » – pour souligner la dimension analogique
dans la pensée primitive, chez l’enfant et dans l’art. Il s’agit moins de
mettre à distance l’homme primitif que de montrer la persistance d’un penser
analogique qui procède par identification à l’objet et de la partie au tout.
Le chapitre 2,
« Analogie et logique » (p. 45-71) précise le statut de
l’analogie relativement à la logique et au principe d’identité. Platon montre
qu’entre l’identité et la dissemblance existe toute une échelle de degrés de
similitude (p. 45). C’est le coup d’envoi de la « pensée
européenne » et la détermination de l’espace de l’analogie volontaire. Celle-ci
passe souvent pour suppléer à l’identité. Elle est en vérité le moyen « de
la compréhension du concept d’exemple en exemple » et finalement le
« contenu véritable du concept », en tant qu’il peut « mettre en
mouvement un développement de pensées » – ainsi du passage du cercle à
l’hyperbole dans les sections coniques (p. 58-59). L’analogie n’est ni
induction ni déduction, mais passage du particulier au particulier (ce qu’Aristote
appelait non pas raisonnement analogique mais paradigmatique) (p. 62).
Avant
d’approfondir le rôle de l’analogie en sciences, le chapitre 3, « L’analogie
entre les fonctions de la connaissance » (p. 73-91), souligne la
continuité analogique entre les diverses fonctions psychiques, en partant
notamment des processus de synthèses propres à la sensation, à l’imagination et
à la réflexion – processus analogues mais pas identiques : les sensations,
par ex., ne sont pas des jugements (p. 73-77). Ainsi observe-t-on une
continuité entre le sens commun et la pensée scientifique, comme l’a bien
montré Meyerson. Même entre la conception primitive de la durée et la mesure du
temps dans la physique relativiste existent des analogies : les deux n’ont
de sens qu’à condition du contraste entre un élément stable et un élément
changeant (p. 80-82). On retrouve dans l’histoire des sciences des thèmes,
oppositions ou idées directrices qui valent comme paradigmes et ouvrent, par
analogie, à de nouveaux domaines, par ex. la constance de l’énergie (p. 87-88).
Le chapitre 4,
« L’analogie entre les domaines de la connaissance » (p. 93-144)
précise les conditions de ce passage de domaine en domaine et la fonction
épistémique de l’analogie. La thèse principale en est que la science moderne
opère par une « analogie entre les séries des objets successifs et
simultanés et les séries de causes et conséquences de nombres, de temps, de
degrés et de lieux » (p. 108), ou encore : «toute science
expérimentale exacte repose sur une correspondance entre les séries
quantitatives et qualitatives» (p. 68). C’est ce que Kant a exposé dans
« son chef d’œuvre », les « Analogies de l’expérience », où
il montre, via la théorie du schématisme, que la causalité est une application
analogique des catégories logiques. Malgré la tentative romantique de retour à
l’identité (Hegel), la physique contemporaine suit cette voie analogique, par
ex., après Maxwell et Mach, dans le modèle atomique de Niels Bohr (notons qu’il
fut l’élève de Høffding). Cela suppose une conception compréhensive et non
explicative de la connaissance scientifique (p. 110-115). L’auteur aborde
ensuite la question de l’analogie en biologie, dans les sciences de l’esprit et
en éthique, en considérant particulièrement l’usage analogique des catégories
de « totalité » et d’« évolution » (p. 119-139).
Le vaste domaine de l’analogie involontaire ne s’est pas seulement différencié dans l’analogie scientifique mais également dans les « analogies émotionnelles » de la poésie et de la religion, qui conservent, plus que l’analogie scientifique, les traits de la « participation primitive » ; c’est l’objet du bref chapitre 5, «Symbolique poétique et religieuse» (p. 144-154).
M. A.