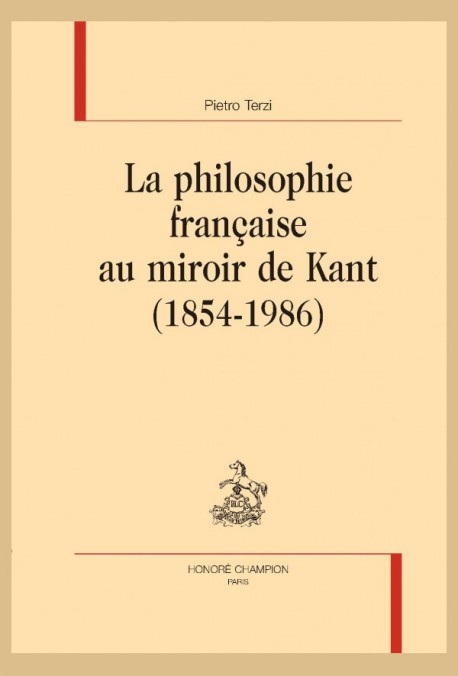
Ce fort volume, tiré d’une thèse de doctorat, a pour ambition d’identifier dans le détail de son développement historique, l’importance de la discussion et de l’interprétation de l’œuvre de Kant dans les grands courants philosophiques français. Outre de brèves introduction et conclusion, une très riche bibliographie (45 pages) et un index nominum particulièrement utile, cette histoire de « la métamorphose historique de la pensée française » à la lumière de Kant est constituée de trois parties. À grands traits, le propos traverse les œuvres et enjeux suivants : 1) « La critique et la réflexion » (1854-1880), moment d’instauration de la philosophie kantienne dans le paysage philosophique français (p. 25-253), notamment chez Cournot et Renouvier, conduisant la critique kantienne de la science vers le primat de la raison pratique, puis son adaptation au spiritualisme de Lachelier, mais aussi via le motif du libre jeu dans les discussions constitutives de l’esthétique française. 2) « L’intuition et le jugement » (1880-1929) : moment de consolidation durant lequel Kant devient incontournable
(p. 257-449), que ce soit avec Bergson en opposition au cadre gnoséologique dans lequel Kant est alors compris, ou avec Brunschvicg dont l’intellectualisme discute et reprend l’idée d’une méthode critique fondée sur l’analyse des jugements mais corrigée par les acquis de la science, notamment en direction d’une conception dynamique et créatrice de l’activité de la pensée et d’une redéfinition de la rationalité intégrant l’histoire. Ces deux pôles permettent de comprendre le rapport à Kant chez ceux qui seront directement influencés : Le Roy, Lalande, Politzer et Aron ; mais aussi chez Alain dont la différence de tonalité de lecture de Kant, davantage réaliste, sera décisive pour la génération suivante, voulant diriger la réflexion vers le concret. 3) « Le transcendantal et la raison » (1929-1986) : moment que Terzi comprend à partir d’une crise de légitimité de la philosophie qui s’inscrit dans la continuité de la correction du kantisme opérée par Brunschvicg et les problèmes pointés par Bergson, avec cette fois-ci d’un côté l’apparition de nouveaux cadres intellectuels (marxisme, psychanalyse, phénoménologie, ontologie heideggérienne, Nietzsche), et de l’autre des philosophes en prise avec les sciences humaines (p. 453-677). Terzi met l’accent sur l’importance de la continuité des études académiques sur Kant malgré les critiques portées sur son œuvre, mais aussi l’apparition d’un dialogue plus libre, évacuant la dimension formaliste de l’a priori kantien, et davantage fécond, cherchant via Kant à sortir la phénoménologie de l’idéalisme husserlien chez Ricoeur, et poursuivant dans la voie tracée par l’interprétation de Brunschvicg afin de penser l’historicité de la raison chez les épistémologues. Le dernier chapitre questionne les retours à Kant opérés par Foucault, Deleuze, Derrida et Lyotard et met en évidence la marginalité commune de leur situation institutionnelle par rapport à l’université, et le rôle d’ancrage que joue Kant pour eux, en particulier concernant la poursuite de la réflexion sur l’homme qu’ils engagent contre les néokantiens et, de manière significative pour Terzi, dans le cadre d’un engagement en faveur d’une « pensée de gauche »
(p. 679).
Le principal intérêt de cette entreprise, qui en est aussi la grande difficulté, tient dans la délimitation du corpus car l’enjeu est de réussir à déterminer la relation entre Kant et la philosophie française. Le choix opéré se comprend à partir d’un constat : il n’y a pas de néokantisme français et pourtant Kant apparaît omniprésent. La question est alors la suivante : quel rôle a joué Kant ? La réponse de Terzi est double : la philosophie kantienne a façonné de l’extérieur les problèmes, méthodes et doctrines français et ainsi contribué à leur métamorphose,
« mais elle l’a fait en se transformant elle-même » (p. 15) au sens où l’œuvre kantienne s’est pluralisée en interprétations, s’est décomposée en concepts, s’est cristallisée en méthodes. Entre la première reprise du projet kantien par Renouvier en 1854 et les débats traversant l’héritage de mai 68, du marxisme et de la déconstruction, cette histoire impressionne par l’ampleur de son érudition et ses effets de clarifications tant sur des grandes distinctions entre traditions philosophiques, qu’au sein de controverses techniques, quelquefois oubliées mais se révélant cruciales. L’œuvre de Kant apparaît comme celle envers laquelle il faut se positionner, et par là fonctionne comme configuratrice non seulement pour les systèmes, mais aussi pour les institutions. Car, et c’est un autre point remarquable de cette entreprise, l’histoire de Terzi prend en considération, notamment au début de chaque partie, le contexte politique, social, biographique et académique pour apprécier la détermination des « nœuds historico-conceptuels » (p. 20) où se joue la présence de Kant.
M. C.